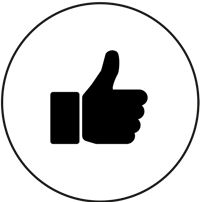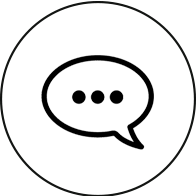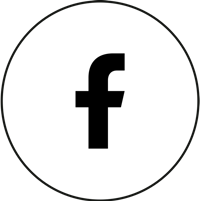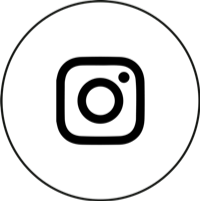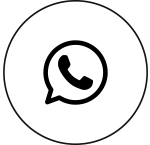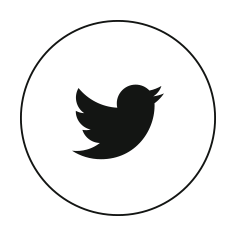Depuis l’annonce par le ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, de l’interdiction à venir de l’abaya à l’école en France, une controverse politique a émergé.
Certains estiment que cette longue robe traditionnelle constitue un « signe religieux ostensible » contraire à la laïcité, tandis que d’autres considèrent cette décision comme inconstitutionnelle. Le parti politique La France insoumise (LFI) a déclaré son intention de saisir le Conseil d’État à ce sujet.
L’abaya est une longue robe traditionnelle qui se porte par-dessus les vêtements, couvrant tout le corps jusqu’aux chevilles, à l’exception du visage, des mains et des pieds. Bien qu’en Arabie saoudite, l’abaya noire ait été obligatoire pour les femmes dans l’espace public jusqu’en 2018, elle est restée courante malgré la levée de cette obligation.
Le qamis, une version masculine de cette tenue, est porté dans de nombreux pays arabes et certains pays africains.
Gabriel Attal, depuis sa nomination à l’Éducation nationale, a considéré le port de l’abaya à l’école comme un « geste religieux » mettant à l’épreuve la laïcité de l’école républicaine. En conséquence, le ministre a annoncé l’interdiction de l’abaya à l’école, arguant que l’appartenance religieuse des élèves ne devrait pas être identifiable en les observant en classe.
Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a quant à lui soutenu que l’abaya n’est pas un signe religieux musulman, la qualifiant de « forme de mode ».
Selon Haoues Seniguer, expert en islamisme, l’abaya est plus ambiguë qu’un simple voile, et son caractère religieux dépend de l’interprétation de celles qui la portent.
En termes de chiffres, environ 150 établissements sur un total de près de 60 000 sont concernés par cette question sur l’ensemble du territoire français, selon une note officielle. Les atteintes à la laïcité à l’école ont augmenté de 120 % entre l’année scolaire 2021-2022 et 2022-2023, avec une augmentation de plus de 150 % du port de signes et de tenues religieuses au cours de la dernière année scolaire, totalisant ainsi 4 710 signalements pour atteintes à la laïcité à l’école en 2022.
La loi du 15 mars 2004 interdit le port de signes ou tenues religieuses ostensibles dans les écoles publiques en France. Une circulaire du 18 mai 2004 précise qu’il s’agit de signes permettant une reconnaissance immédiate de l’appartenance religieuse, tels que le voile islamique, la kippa ou une croix de taille manifestement excessive. Une circulaire du 9 novembre 2022 du ministère de l’Éducation nationale inclut les abayas, ainsi que d’autres tenues, parmi les vêtements pouvant être interdits s’ils sont portés de manière à manifester ostensiblement une appartenance religieuse.
La France insoumise (LFI) a annoncé son intention de saisir le Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative, considérant que cette réglementation est contraire à la Constitution et susceptible d’entraîner des discriminations envers les jeunes femmes de confession musulmane. Ils font valoir que les autorités religieuses musulmanes ne considèrent pas l’abaya comme une tenue religieuse, remettant ainsi en question la nécessité de son interdiction.
Article écrit par : Yann Kabou
—
La plateforme NOTRECONTINENT.COM a pour vocation de diffuser gratuitement et librement les informations et opinions provenant des citoyens, des associations, des ONG ou des professionnels au Sénégal. Cliquez-ici pour créer votre compte et publier votre article.