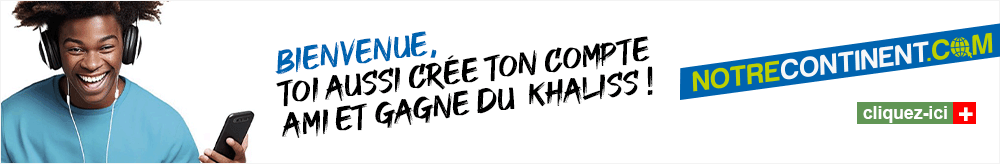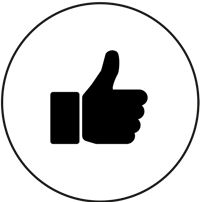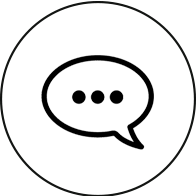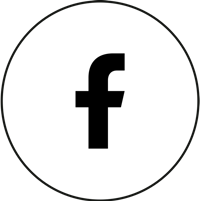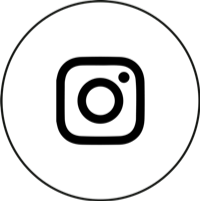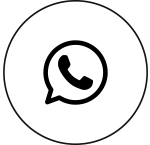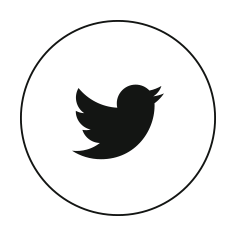Parler de démocratie au Sénégal au XXIe siècle sans évoquer l’inclusion des jeunes et des femmes dans la vie politique relève d’un non-sens. Pourtant, au Sénégal, malgré quelques avancées notables, la réalité reste marquée par une sous-représentation chronique de ces deux groupes, pourtant largement majoritaires dans la population. Il est grand temps de corriger cette anomalie démocratique.
Les jeunes représentent plus de 60 % de la population sénégalaise, et les femmes en constituent plus de la moitié. Malgré cela, leur présence dans les sphères de décision reste marginale. La classe politique est encore dominée par des figures masculines âgées, qui verrouillent les postes clés et reproduisent des schémas de gouvernance peu ouverts au renouvellement.
Même la loi sur la parité, adoptée en 2010, bien qu’historique, reste souvent appliquée de manière formelle : les femmes figurent sur les listes électorales mais sont rarement positionnées à des places éligibles ou décisionnelles. Quant aux jeunes, ils sont souvent relégués à des fonctions subalternes, considérés comme des exécutants plutôt que comme des acteurs à part entière.
Cette marginalisation n’est pas seulement une injustice, elle est aussi un frein au progrès. Les jeunes et les femmes possèdent une capacité d’innovation, une connaissance directe des réalités sociales et une énergie qui font cruellement défaut à la politique sénégalaise.
Ce sont eux qui vivent de plein fouet les problèmes d’accès à l’emploi, à l’éducation, à la santé, et ils doivent donc participer à la conception des politiques qui les concernent. Exclure ces voix, c’est priver la démocratie au Sénégal de perspectives nouvelles, plus proches des préoccupations du quotidien.
Mais pour que leur implication devienne réelle, il faut dépasser les simples discours. Les partis politiques doivent s’ouvrir davantage à la diversité des profils, instaurer une culture de renouvellement et donner de réelles responsabilités aux jeunes et aux femmes. Cela implique aussi de transformer les mentalités : sortir de l’idée que jeunesse rime avec inexpérience, ou que la femme est moins apte à diriger. Les institutions publiques doivent également jouer un rôle en appliquant des règles plus contraignantes sur la représentation, non seulement en nombre, mais aussi en influence.
Parallèlement, les jeunes et les femmes doivent aussi s’organiser, se former, s’exprimer et revendiquer leur place avec force. Il ne s’agit pas d’attendre qu’on leur donne la parole, mais de la prendre, dans les partis, dans les mouvements citoyens, dans les médias et dans la rue s’il le faut. Car la démocratie au Sénégal ne se renforce que lorsque chacun y participe pleinement.
Au fond, l’avenir de la démocratie au Sénégal dépendra de sa capacité à devenir véritablement inclusive. Une démocratie où l’on gouverne avec, et non pour, les jeunes et les femmes. Ne pas le comprendre, c’est se condamner à une politique figée, déconnectée, et incapable de répondre aux défis d’un monde en pleine mutation.
Article opinion écrit par le créateur de contenu : Yoann Barro.
Mis en ligne : 11/05/2025
—
La plateforme NOTRECONTINENT.COM permet à tous de diffuser gratuitement et librement les informations et opinions provenant des citoyens. Les particuliers, associations, ONG ou professionnels peuvent créer un compte et publier leurs articles Cliquez-ici.