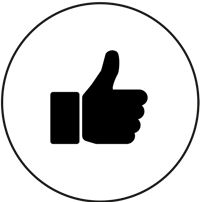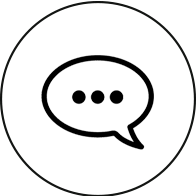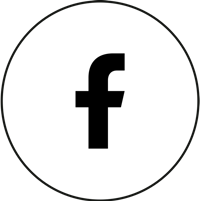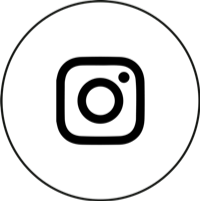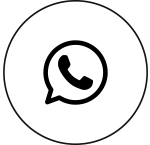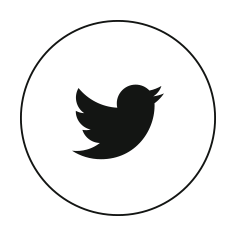Le drame qui a endeuillé Cambérène, la noyade de deux adolescents en fuite lors d’un simple contrôle d’identité, soulève à nouveau la question brûlante du rapport entre jeunesse et forces de l’ordre. À ce rythme, on risque de basculer dans une société où la police sera bientôt interdite d’intervenir face aux agressions. Dénoncer l’imprudence de certains jeunes et la complaisance de ceux qui, systématiquement, transforment chaque intervention policière en réquisitoire.
L’incident survient alors que Dakar concentre déjà un tiers des mineurs « en conflit avec la loi », selon le rapport national 2023 sur la protection judiciaire de l’enfance. Dans le même temps, la Police nationale a procédé, rien qu’en 2024, à plus de 17 000 interpellations pour faits criminels ou délictuels, preuve d’un climat sécuritaire tendu que les autorités tentent de juguler. Ignorer ces chiffres, c’est passer sous silence une réalité qui n’épargne plus aucun quartier populaire.
Le récit officiel parle d’un contrôle routinier, suivi d’une course-poursuite, de tirs de sommation et, finalement, d’un plongeon fatal dans l’Atlantique. Les riverains crient à l’excès de zèle, les réseaux sociaux s’enflamment, et tout bascule dans l’affrontement. Or, quel danger immédiat représentait un contrôle d’identité ? Pourquoi préférer la fuite et la mort, au dialogue ? Cette tragédie illustre un phénomène devenu récurrent : la rupture de confiance entre une frange de la jeunesse et l’autorité, entretenue par une rhétorique anti‑police systématique.
Une délinquance juvénile en hausse. Le même rapport signale plus de 11 000 mineurs suivis par les services d’action éducative en 2023, dont 22 % pour infractions pénales. Feindre de ne voir là qu’un “désœuvrement” revient à minimiser des actes parfois violents et organisés.
Une police à la tâche ardue. Les 61 % de faits élucidés en matière de vols ou cambriolages démontrent des services d’enquête mobilisés, mais aussi sollicités jusqu’à la saturation. À force de délégitimer chaque contrôle, on finira par interdire aux agents d’intervenir, offrant un blanc‑seing aux agresseurs.
L’exemple français. Après la mort de Nahel à Nanterre en 2023, la France a connu une semaine d’émeutes, un milliard d’euros de dégâts et un traumatisme durable. Un an plus tard, le sentiment d’injustice demeure et la fracture police‑population s’est aggravée. Voulons‑nous reproduire ce schéma ?
Responsabilité individuelle et collective. Fuir la police au point de risquer sa vie n’est ni un acte héroïque ni une fatalité sociale ; c’est un choix. Ce choix est encouragé lorsque la société confond légitime critique et hostilité de principe.
Dans d’autres villes africaines, Lagos, Abidjan, les autorités ont renforcé les patrouilles fluviales et les brigades de proximité pour réduire les accidents lors de poursuites. Cambérène doit s’inspirer de ces expériences plutôt que d’importer une culture de l’affrontement.
Deux vies perdues, un quartier sous tension et une police sur la sellette : voilà le bilan d’une soirée où la fuite a primé sur le bon sens. Si nous continuons à excuser l’irresponsabilité et à diaboliser ceux qui assurent notre sécurité, nous franchirons bientôt le point de non‑retour.
Article opinion écrit par le créateur de contenu : Babacar Ndao.
Mis en ligne : 02/07/2025
—
La plateforme NOTRECONTINENT.COM permet à tous de diffuser gratuitement et librement les informations et opinions provenant des citoyens. Les particuliers, associations, ONG ou professionnels peuvent créer un compte et publier leurs articles Cliquez-ici.