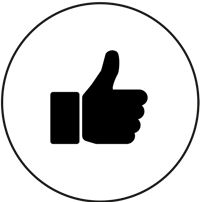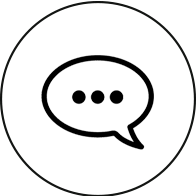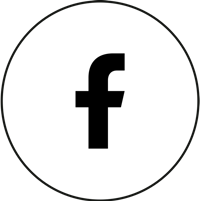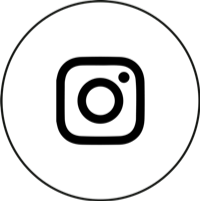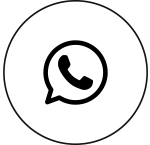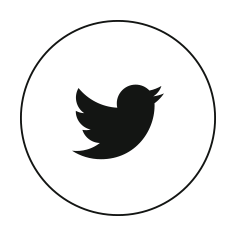C’est un échange inédit depuis 2022. Le président français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine ont renoué le fil du dialogue, après un silence diplomatique de près de trois ans. La dernière fois, ils avaient évoqué la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, menacée par des bombardements.
Cette fois, c’est la situation en Iran – notamment les frappes sur des installations nucléaires – qui a permis la reprise de contact entre Paris et le Kremlin, comme le rapporte La Croix.
Selon le quotidien français, « la crise iranienne a offert une opportunité » à Emmanuel Macron « de réaffirmer le statut de la France comme membre du Conseil de sécurité de l’ONU et responsable de la non-prolifération nucléaire », alors même que les Européens peinent à peser sur l’échiquier géopolitique.
Un appel de près de deux heures, qui survient après la décision unilatérale des États-Unis de frapper des sites nucléaires iraniens, sans consultation préalable de Paris ni de Moscou. Le New York Times rappelle que ni Macron ni Poutine « n’ont été associés à cette opération américaine », ce qui a incité les deux dirigeants à afficher leur propre posture sur le dossier iranien. Le président français y voit une tentative de réinvestir le jeu diplomatique au Moyen-Orient. Quant au président russe, il en profite pour souligner la place de la Russie dans l’ordre mondial, malgré l’isolement croissant du pays depuis l’invasion de l’Ukraine.
Mais sur le front ukrainien, le ton est resté ferme, sans réelle avancée. Le Figaro résume : « Emmanuel Macron s’est heurté à un mur ». Poutine a répété son argumentaire : la guerre serait, selon lui, « une conséquence directe de la politique des États occidentaux », qui auraient « ignoré les intérêts sécuritaires de la Russie depuis des années ».
Côté ukrainien, Ukrainska Pravda souligne que Macron a plaidé pour « l’établissement, dans les meilleurs délais, d’un cessez-le-feu » et l’ouverture de négociations. Il a réitéré « le soutien indéfectible de la France à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine », appuie de son côté Kyiv Post.
Scène surréaliste hier en Floride : le président américain Donald Trump a visité un nouveau centre de rétention destiné aux migrants illégaux. Surnommé déjà « Alligator Alcatraz », l’établissement se situe en pleine zone marécageuse et pourrait accueillir jusqu’à 5 000 personnes. Le Temps décrit un lieu « fait de lits superposés alignés, enfermés dans des cages grillagées, sous des pavillons de toile blanche ».
Fidèle à son style provocateur, Trump s’est moqué des migrants qui, selon lui, n’auraient « aucune chance de s’échapper » car « la faune locale se chargera de les dissuader ». « On a beaucoup de flics sous forme d’alligators – vous n’avez pas besoin de les payer autant », a-t-il ironisé.
Le nom du site, Alligator Alcatraz, fait écho à l’ancienne prison de haute sécurité située dans la baie de San Francisco. Libération y voit une référence « volontairement théâtrale », qui nourrit l’image d’un président dur sur l’immigration à l’approche de la présidentielle.
Pour Le Soir, cette prison illustre parfaitement la volonté de Trump « d’opérer la plus grande expulsion de l’histoire américaine ». Si les chiffres actuels sont encore loin de l’objectif (55 000 personnes détenues et autant expulsées), l’opération satisfait sa base électorale. « Le peuple aura son pain, et ses jeux », conclut le journal belge.
C’est un symbole qui en dit long : le sommet de la tour Eiffel a été fermé ce mardi à Paris, en raison de la vague de chaleur qui frappe l’Europe. La décision, exceptionnelle, marque l’intensité d’un phénomène désormais récurrent. La Republica titre : « La chaleur étouffe l’Europe, Paris en alerte rouge ».
En Italie, la situation est tout aussi critique : plus de vingt villes sont en alerte rouge, et les températures dépassent localement les 40 °C. Face à ce stress thermique, le gouvernement italien a décidé de limiter le travail en extérieur. Un protocole national de protection contre la chaleur doit être signé dans les prochains jours entre syndicats et entreprises.
Mais les conséquences ne sont pas uniquement sanitaires. Le Soir rappelle que ces vagues de chaleur ont un coût économique colossal. Selon l’Agence européenne de l’environnement, elles auraient coûté 45 milliards d’euros à l’économie en 2023. Un chiffre qui pourrait grimper jusqu’à 3 % du PIB annuel d’ici 2060 dans les pays du sud de l’Europe, si rien n’est fait.
En attendant, les records tombent et les symboles s’accumulent. À Paris comme ailleurs, la chaleur devient un acteur central du quotidien, et un défi climatique de plus en plus pressant.
Article écrit par : Mariama Ba
Mis en ligne : 02/07/2025
—
La plateforme NOTRECONTINENT.COM permet à tous de diffuser gratuitement et librement les informations et opinions provenant des citoyens. Les particuliers, associations, ONG ou professionnels peuvent créer un compte et publier leurs articles Cliquez-ici.