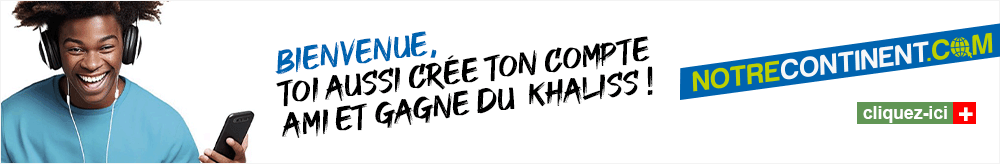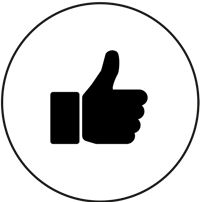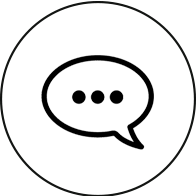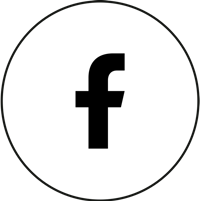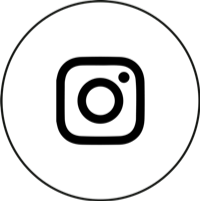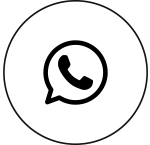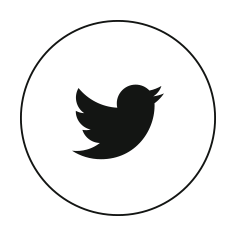Une étude publiée dans The Lancet met en lumière les conséquences dramatiques de la réduction de l’aide internationale orchestrée par les États-Unis. Plus de 14 millions de personnes pourraient mourir d’ici à 2030 à cause des coupes budgétaires massives annoncées sous l’administration Trump. Parmi ces victimes, environ 4,5 millions d’enfants de moins de cinq ans. Cette réduction drastique de 83 % du financement accordé à l’agence américaine USAID menace gravement les progrès accomplis dans la lutte contre des maladies évitables telles que le VIH ou le paludisme. Ce choix politique dépasse le simple regret : il est purement inhumain.
Pendant vingt ans, les programmes financés par l’USAID ont constitué un socle fondamental de la santé publique dans les pays à faibles et moyens revenus. Entre 2001 et 2021, ces initiatives ont permis de sauver 91 millions de vies dans 133 pays.
Et pourtant, l’aide en question représente une part minuscule du budget fédéral américain, à peine 17 cents par jour et par citoyen. C’est cette infime contribution financière qui est aujourd’hui remise en question, alors qu’elle a produit des résultats colossaux. L’idée qu’un tel acquis puisse être anéanti en quelques années est tout simplement sidérante.
Ce retrait américain ne se déroule pas dans un isolement diplomatique. Il s’inscrit dans un contexte global de repli, où d’autres pays donateurs historiques comme l’Allemagne, le Royaume-Uni ou la France réduisent également leur engagement. Ce désengagement collectif survient à un moment critique, alors que le monde est confronté à des menaces sanitaires de plus en plus complexes, qu’il s’agisse de pandémies, de crises humanitaires ou des effets du changement climatique. La tenue récente de la conférence internationale sur le financement du développement, en Espagne, sans la participation des États-Unis, symbolise cette fracture au sein de la communauté internationale.
Mais au-delà des chiffres, ce sont des êtres humains qui paient déjà le prix de ces décisions politiques. Un enfant au Malawi qui ne reçoit plus de traitement contre le VIH, une femme enceinte en Haïti qui dort sans moustiquaire, un adolescent séropositif au Cambodge abandonné par le système de santé : voici les visages réels de cette tragédie silencieuse. Ces maladies sont connues, les traitements sont disponibles, mais sans fonds, les structures de soin ferment, les soignants partent, et les malades meurent.
Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, la réponse mondiale a été rapide et massive. Cela prouve qu’en cas de volonté politique, la solidarité peut sauver des millions de vies. Alors pourquoi ne pas adopter cette même énergie face à des fléaux maîtrisables, mais toujours meurtriers ? Parler de solidarité et de droits humains perd tout son sens si l’on tourne le dos aux plus vulnérables sous prétexte de rigueur budgétaire.
Cette réduction de l’aide n’est pas anodine : elle aura des conséquences humaines irréversibles. Elle érode la confiance entre partenaires internationaux, décourage les soignants sur le terrain, et condamne des millions de personnes à l’abandon.
Les États-Unis, comme les autres bailleurs historiques, ont une responsabilité morale et historique. Il faut restaurer, voire augmenter les financements destinés à la santé mondiale. Faillir à cette mission, c’est devenir complice silencieux d’un désastre évitable.
Article opinion écrit par le créateur de contenu : Mansour Samba.
Mis en ligne : 12/07/2025
—
La plateforme NOTRECONTINENT.COM permet à tous de diffuser gratuitement et librement les informations et opinions provenant des citoyens. Les particuliers, associations, ONG ou professionnels peuvent créer un compte et publier leurs articles Cliquez-ici.