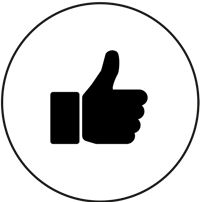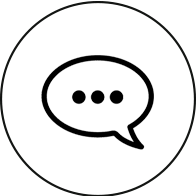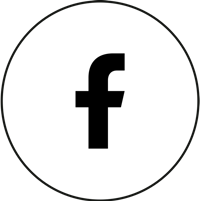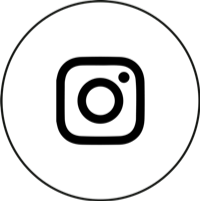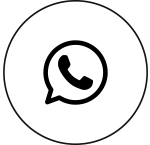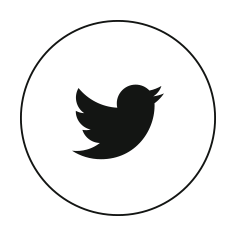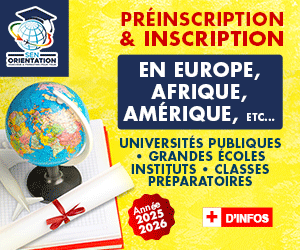Ils cessent de s’alimenter non par désinvolture, mais parce qu’ils n’ont plus rien d’autre à opposer. En Afrique, les grèves de la faim en milieu carcéral sont souvent la dernière option pour des détenus qui cherchent à se faire entendre.
C’est un acte de résistance extrême, une manière de briser le mur de silence qui les entoure. Et pourtant, ces gestes sont accueillis avec un mépris glaçant par les autorités, comme si leur souffrance n’avait pas de poids, pas de voix, pas d’existence.
Ce désintérêt institutionnel est une forme de violence en soi. Dans de nombreux pays du continent, la logique sécuritaire prévaut largement sur les principes de justice et de dignité. Les détenus, une fois enfermés, sont effacés du champ social. Leur santé, leur détresse, leurs appels à l’aide ne suscitent que peu de réactions. Les gouvernements préfèrent ignorer que ces corps qui s’éteignent lentement posent des questions dérangeantes sur les conditions carcérales et les abus judiciaires.
La grève de la faim n’est pas une mise en scène. Elle est l’expression d’un désespoir pur, un cri lancé depuis les ténèbres des cellules pour dénoncer des injustices parfois flagrantes : détentions arbitraires, procès biaisés, mauvais traitements, accès médical refusé. Il s’agit rarement de caprices ou d’ultimatums absurdes. Dans bien des cas, les prisonniers ne réclament rien d’autre qu’un procès équitable, un minimum d’attention, un respect de leurs droits les plus élémentaires.
Ce qui choque profondément, c’est l’absence de mobilisation autour de ces grèves. Là où, dans d’autres régions du monde, une telle action pourrait alerter les médias, provoquer des réactions d’ONG ou des débats publics, en Afrique, ces gestes tombent dans un vide absolu. L’étiquette politique ou idéologique suffit souvent à discréditer toute plainte. Certains détenus sont immédiatement catalogués comme « terroristes », « factieux » ou « ennemis de la République », ce qui légitime leur mise au silence.
Le silence de la société civile face à ces drames est tout aussi préoccupant. Les associations des droits humains, les avocats, les journalistes, les intellectuels, même les artistes restent souvent absents. Ce manque d’indignation collective permet à l’État de persévérer dans sa posture autoritaire. Pourtant, chaque prisonnier qui met sa vie en jeu dans une cellule, loin des caméras, nous interroge sur ce que nous acceptons en silence au nom de la stabilité ou de l’ordre.
Il est temps d’entendre ces grèves de la faim non comme des actes marginaux, mais comme des signaux d’alarme. Un État qui accepte que ses prisons deviennent des zones de non-droit renonce à sa propre légitimité. On peut débattre des délits ou des faits reprochés aux détenus, mais on ne peut plus ignorer qu’en refusant de garantir leur dignité, les autorités sapent les fondements mêmes de la justice. Ne pas écouter ces corps affamés, c’est laisser mourir aussi un peu de notre humanité.
Article opinion écrit par le créateur de contenu : Pathé.
Mis en ligne : 25/04/2025
—
La plateforme NOTRECONTINENT.COM permet à tous de diffuser gratuitement et librement les informations et opinions provenant des citoyens. Les particuliers, associations, ONG ou professionnels peuvent créer un compte et publier leurs articles Cliquez-ici.