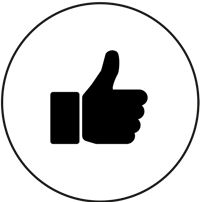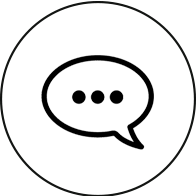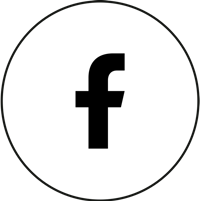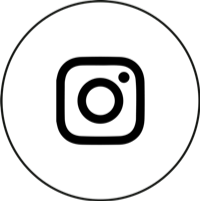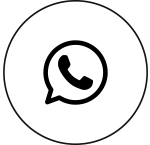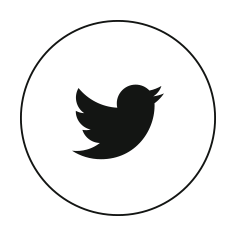Dans la région de Kédougou, au sud-est du Sénégal, à la frontière de la Guinée et du Mali, les femmes et les enfants sont particulièrement exposés à des risques sanitaires liés à l’utilisation du mercure dans l’orpaillage artisanal au Sénégal.
Cette région, éloignée de Dakar, voit se développer un secteur minier informel où le mercure, utilisé pour extraire l’or du minerai, est largement répandu, malgré ses effets toxiques connus. Faute d’alternatives accessibles et d’une réglementation efficace, ce métal continue de contaminer les écosystèmes locaux et les populations qui en dépendent.
Le mercure est une substance hautement toxique pour le système nerveux. Pourtant, dans une grande partie de l’Afrique de l’Ouest, il demeure la méthode principale utilisée pour le traitement de l’or, notamment dans les exploitations artisanales et illégales. L’orpaillage artisanal au Sénégal est un secteur en plein essor, où des femmes comme Sadio Camara, orpailleuse, manipulent régulièrement ce produit sans protection. Selon elle, le manque de moyens et d’information pousse les femmes à se tourner vers cette méthode malgré les dangers : « Si vous n’avez pas les moyens, vous ne vous souciez pas des conséquences », affirme-t-elle.
Des alternatives existent, comme la séparation par gravité, qui permet de traiter l’or sans mercure à l’aide de machines spécifiques. En 2020, le gouvernement sénégalais avait annoncé la construction de 400 unités de traitement sans mercure. Mais à ce jour, seule une unité a été mise en place, laissant les orpailleurs sans solutions concrètes. Pendant ce temps, de nombreuses femmes continuent de travailler dans des conditions dangereuses, lavant des tonnes de sédiments à la recherche de quelques grammes d’or dans le cadre de l’orpaillage artisanal au Sénégal.
Certaines, comme Doudou Dramé, estiment que les petites quantités de mercure qu’elles utilisent ne posent pas de problème. Mais cette substance s’évapore dans l’air, se disperse dans les sols et se déverse dans les rivières après les pluies. Les effets sont souvent invisibles à court terme, ce qui entretient l’illusion d’un risque inexistant. « Si le mercure faisait mal immédiatement, les gens l’éviteraient. Mais ses effets apparaissent bien plus tard », explique-t-elle.
Enfin, cette pollution touche particulièrement les femmes, principales utilisatrices de l’eau pour les tâches domestiques. Modou Goumbala, membre de l’ONG La Lumière, souligne que les femmes, faute d’eau potable, utilisent directement les rivières contaminées pour faire la vaisselle, laver les enfants ou faire la lessive. En l’absence de solutions efficaces, les chefs de village craignent que le mercure ne continue de faire des ravages silencieux dans les communautés minières de la région.
Article écrit par : Yann Kabou
Mis en ligne : 13/05/2025
—
La plateforme NOTRECONTINENT.COM permet à tous de diffuser gratuitement et librement les informations et opinions provenant des citoyens. Les particuliers, associations, ONG ou professionnels peuvent créer un compte et publier leurs articles Cliquez-ici.