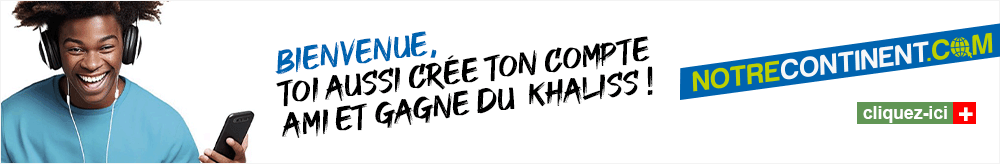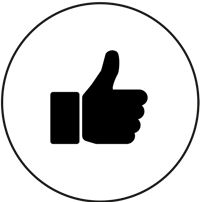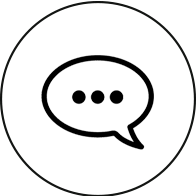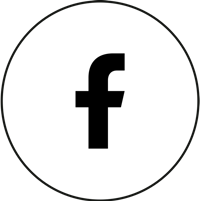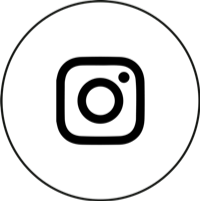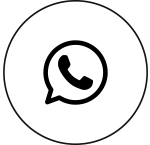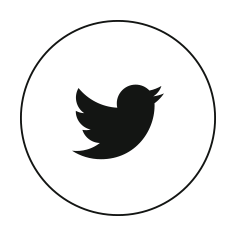Lors de la commémoration du 23 juin 2011, Aminata Touré a brandi l’étendard de la justice pour les victimes de répression politique. Or, derrière ce discours se cache une figure qui a longtemps été l’un des rouages du système qu’elle dénonce aujourd’hui. Il est impossible de prendre au sérieux ces homélies démocratiques lorsqu’elles émanent d’une actrice qui, hier encore, consolidait la machine autoritaire de Macky Sall.
Rappelons les faits. « Mimi » Touré fut ministre de la Justice de 2012 à 2013 avant d’être propulsée Première ministre (2013-2014). Durant cette période, elle pilote la redoutée Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), bras armé d’une traque sélective qui fait tomber surtout les adversaires du pouvoir, au premier rang desquels Karim Wade. Son silence d’alors sur les arrestations arbitraires et la brutalité policière contraste crûment avec ses sermons actuels.
En militant aujourd’hui contre les dérives qu’elle a contribué à installer, Aminata Touré tente une opération de blanchiment mémoriel : faire oublier qu’elle fut le visage judiciaire d’un régime qui a emprisonné des opposants, bâillonné la presse critique et matraqué les manifestants. Les morts de mars 2021 quatorze jeunes abattus en cinq jours ont marqué au fer rouge la conscience nationale ; mais où était la voix indignée de l’ex-Premier ministre ?
Même après son éviction, elle est restée proche du Palais jusqu’en 2022, avant de se métamorphoser, opportunément, en vigie démocratique au moment où son propre avenir politique était menacé.
Coreligionnaire des abus : en tant que ministre de la Justice, Aminata Touré a cautionné sinon orchestré une justice à géométrie variable, sans jamais dénoncer les détentions préventives abusives ni les procès expéditifs visant l’opposition.
Silence sur les bavures policières : les 14 morts de 2021 et les 23 décès de 2023 n’ont suscité aucune autocritique de sa part sur l’environnement qu’elle a co-construit.
Instrumentalisation de la mémoire : revendiquer soudain la « justice pour les martyrs » sans reconnaître sa propre responsabilité revient à confisquer leur cause au profit d’ambitions électorales.
Absence de cohérence programmatique : appeler aujourd’hui à la refondation institutionnelle tout en demeurant floue sur les mécanismes concrets (réforme des forces de sécurité, indépendance du parquet, etc.) relève du slogan, pas du courage politique.
Aminata Touré n’est pas un cas isolé. En Côte d’Ivoire, l’ex-Premier ministre Guillaume Soro vilipende aujourd’hui les excès d’Alassane Ouattara qu’il a pourtant aidé à installer ; au Malawi, Joyce Banda s’est muée en pourfendeuse des dérives qu’elle couvrait hier.
Ces volte-faces dessinent un même pattern : des dignitaires devenus critiques sitôt exclus de la table du pouvoir, espérant se reconvertir en champions du peuple.
La démocratie sénégalaise n’a pas besoin de repentis tardifs ; elle a besoin d’acteurs constants, prêts à dénoncer l’injustice même lorsqu’ils bénéficient du système. Exiger la vérité sur les crimes d’État est légitime, mais cette exigence doit d’abord s’accompagner d’une introspection impitoyable. N’accorder plus de blanc-seing moral à ceux qui ont contribué aux dérives qu’ils fustigent aujourd’hui. Citoyennes, citoyens, réclamer des comptes : que les anciens dignitaires commencent par reconnaître leurs fautes, à défaut de quoi leurs discours resteront de simples manœuvres de recyclage politique.
Article opinion écrit par le créateur de contenu : Paul Diatta.
Mis en ligne : 24/06/2025
—
La plateforme NOTRECONTINENT.COM permet à tous de diffuser gratuitement et librement les informations et opinions provenant des citoyens. Les particuliers, associations, ONG ou professionnels peuvent créer un compte et publier leurs articles Cliquez-ici.