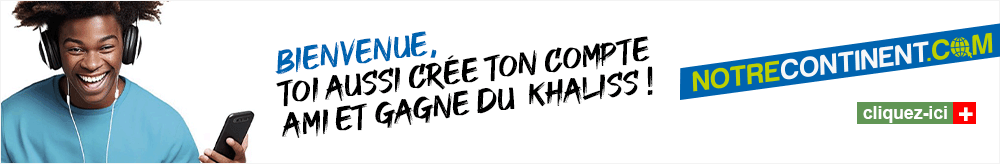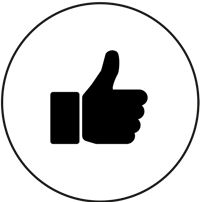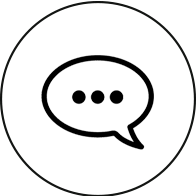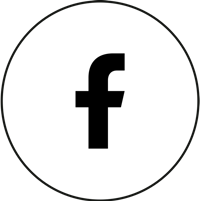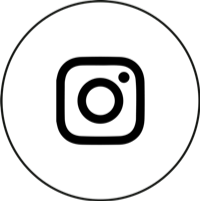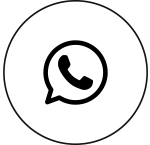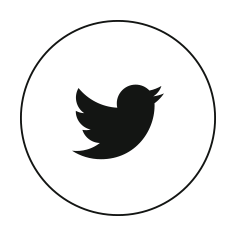L’Élysée s’en félicite : Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont enfin repris langue, après près de trois ans de silence. Deux heures de conversation, dit‑on, consacrées à l’Ukraine et au nucléaire iranien. Ces échanges téléphoniques sont voués à l’échec. M. Poutine n’a jamais manifesté la moindre volonté sincère de clore la guerre qu’il a lui‑même déclenchée, et Paris entretient l’illusion d’une diplomatie « active » qui, en réalité, le conforte.
Depuis l’invasion de février 2022, le front s’est enlisé mais la violence s’intensifie : les frappes russes se sont encore abattues fin juin sur Odessa et Kharkiv, tandis que Moscou accélère la production d’avions‑bombardiers et de drones. À Kiev, les pertes civiles s’accumulent ; à Moscou, le pouvoir consolide son économie de guerre. Dans ce climat, l’unique précédent échange Macron‑Poutine (septembre 2022) n’avait débouché sur rien, pas même une pause humanitaire.
Les scénarios se répètent : Poutine décroche, écoute poliment, puis exige la reconnaissance de ses conquêtes et la mise sous tutelle de l’Ukraine avant toute trêve. Hier encore, il conditionnait une paix « globale » à la prise en compte de « nouvelles réalités territoriales ». En mai, Reuters révélait qu’il exigeait en outre l’arrêt définitif de l’élargissement de l’OTAN. C’est exactement la technique utilisée lors des accords de Minsk : multiplier les préconditions jusqu’à rendre toute négociation impossible, tout en faisant porter la responsabilité de l’impasse à l’Occident. Pire, plusieurs capitales ont constaté que chaque tentative de “détente” se soldait, quelques jours plus tard, par un regain de bombardements ; le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, refuse désormais tout appel direct avec le Kremlin pour cette raison précise
Aucune évolution de fond : les revendications du Kremlin restent maximalistes et non négociables pour Kiev comme pour ses partenaires.
Un calendrier cynique : ces coups de fil surviennent toujours à l’approche de sommets internationaux. Ils visent à semer le doute parmi les Alliés et à offrir au chef du Kremlin l’image d’un interlocuteur « raisonnable ». Le récent sommet de La Haye a illustré ces divisions : quand Washington imaginait un Poutine prêt au compromis, plusieurs Européens alertaient sur ses ambitions intactes au‑delà de l’Ukraine.
Une stratégie de l’épuisement : en soutenant la conversation pour la conversation, Moscou gagne un temps précieux, reconstitue ses forces et teste la lassitude occidentale. Des analystes proches de l’Atlantic Council parlent même d’une « tactique de temporisation » destinée à « user la patience » des démocraties.
Des précédents éclairants : qu’il s’agisse de la Syrie, de la Géorgie ou du Donbass avant 2022, chaque cessez‑le‑feu arraché à grand‑peine a été violé dès que Moscou y voyait un intérêt stratégique.
Le procédé rappelle les interminables pourparlers nord‑coréens : salves diplomatiques, engagement verbal, aucun résultat tangible. De même, les « accords » de Sotchi sur la Syrie (2018) n’ont pas empêché la reprise des bombardements d’Idlib quelques semaines plus tard. Dans tous ces cas, le Kremlin instrumentalise la table des négociations comme un théâtre, jamais comme un lieu de compromis.
Persister à décrocher, c’est cautionner la mascarade. La France gagnerait à concentrer ses efforts sur un soutien militaire et économique massif à l’Ukraine, à renforcer le régime de sanctions et à travailler à une unité transatlantique sans faille plutôt qu’à ménager une ligne directe dont Moscou se sert comme d’un mégaphone. Ne confondons plus diplomatie et naïveté : face à un agresseur qui ne cherche qu’à geler le conflit à son avantage, la seule réponse responsable est la fermeté.
Article opinion écrit par le créateur de contenu : Ousmane Ka.
Mis en ligne : 02/07/2025
—
La plateforme NOTRECONTINENT.COM permet à tous de diffuser gratuitement et librement les informations et opinions provenant des citoyens. Les particuliers, associations, ONG ou professionnels peuvent créer un compte et publier leurs articles Cliquez-ici.