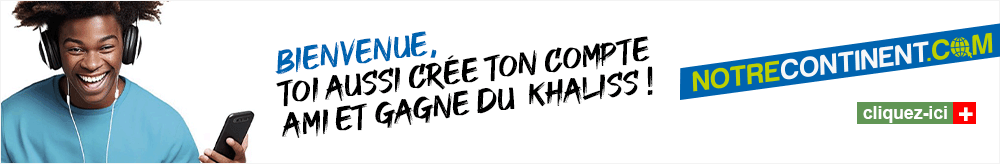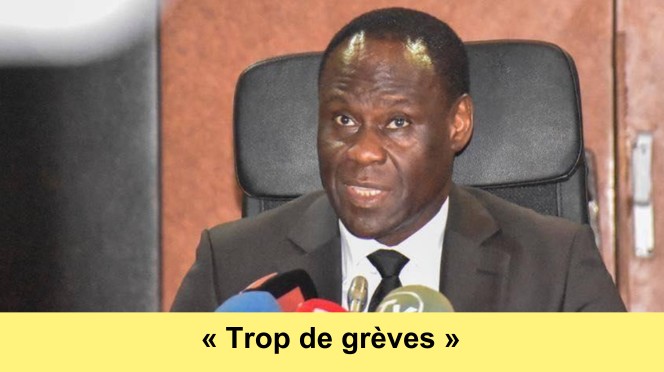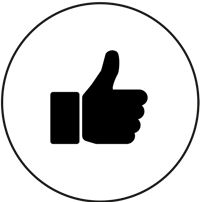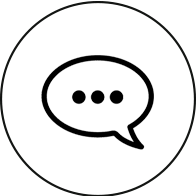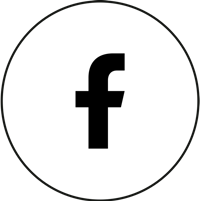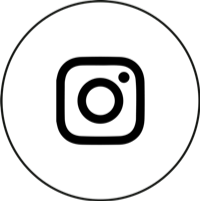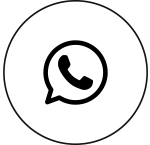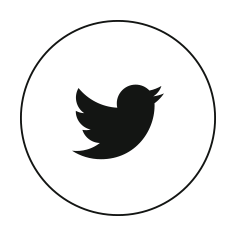Depuis le 30 juin, le Syndicat des Travailleurs de la Justice (Sytjust) et l’Union nationale des Travailleurs de la Justice (Untj) ont entamé une nouvelle grève de 72 heures, invoquant un « mépris persistant » de la part du gouvernement face à leurs revendications. Si les frustrations exprimées sont compréhensibles, les conséquences néfastes de ces arrêts de travail répétés sur l’accès à la justice et sur le quotidien des citoyens ordinaires ne peuvent être ignorées.
Le système judiciaire sénégalais est confronté depuis de longues années à des difficultés structurelles : lenteur dans le traitement des dossiers, manque de personnel, surpopulation carcérale, et déficit de moyens logistiques. À cela viennent désormais s’ajouter des grèves cycliques qui paralysent le fonctionnement des tribunaux, reportent les audiences, ralentissent les procédures et aggravent la frustration des justiciables. Ces perturbations ajoutent à la crise de confiance entre la population et l’institution judiciaire.
Le Sytjust et l’Untj dénoncent l’absence de négociations sérieuses et appellent à une mobilisation générale dans tous les organes judiciaires. Pourtant, cette stratégie de confrontation systématique, fondée sur la répétition des grèves, ne semble pas porter ses fruits. Depuis plusieurs années, ces mouvements sociaux se succèdent, sans que de véritables avancées concrètes n’émergent durablement. En réalité, ils contribuent davantage à une forme d’usure généralisée, tant du côté des travailleurs que des usagers du service public.
Le premier impact de ces grèves touche les justiciables : des mères en attente d’un jugement pour la pension alimentaire, des détenus provisoires dont la liberté dépend d’un procès reporté, des citoyens ordinaires à la recherche d’un document administratif, et même des entreprises bloquées dans des litiges commerciaux. Chaque grève reporte la justice, et toute justice différée devient une injustice en soi.
Dans plusieurs pays africains, comme le Rwanda ou le Ghana, des réformes structurelles ont été menées pour améliorer les conditions de travail des acteurs judiciaires sans recourir à des paralysies répétées du système. Ces pays ont privilégié des cadres de dialogue permanents, indépendants du calendrier politique, et des mécanismes de médiation salariale qui garantissent une continuité du service public. Le Sénégal gagnerait à s’inspirer de ces exemples, au lieu de s’enliser dans une logique de bras de fer.
Le droit syndical est légitime. Les revendications des travailleurs de la justice doivent être entendues. Mais la grève à répétition ne saurait être la seule issue. D’autres formes de mobilisation, plus créatives et moins punitives pour le citoyen, pourraient être explorées : « journées noires » symboliques sans blocage, campagnes d’alerte médiatique ou actions coordonnées avec la société civile.
Le service public de la justice est un pilier fondamental de l’État de droit. À ce titre, il ne peut être pris en otage par des conflits sociaux sans issue visible. L’État doit bien sûr assumer ses responsabilités, mais les syndicats doivent, eux aussi, reconsidérer leur stratégie. Le droit à la justice, qu’ils invoquent à juste titre, ne peut être défendu en privant les citoyens de ce même droit. Un appel ferme doit être lancé pour sortir de ce cercle vicieux qui affaiblit, jour après jour, l’institution judiciaire sénégalaise.
Article opinion écrit par le créateur de contenu : Assane Dieng.
Mis en ligne : 04/07/2025
—
La plateforme NOTRECONTINENT.COM permet à tous de diffuser gratuitement et librement les informations et opinions provenant des citoyens. Les particuliers, associations, ONG ou professionnels peuvent créer un compte et publier leurs articles Cliquez-ici.