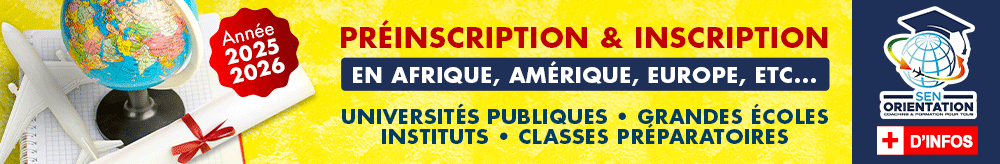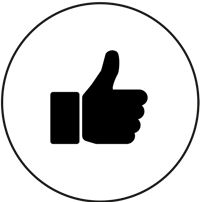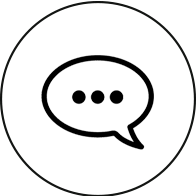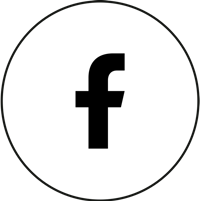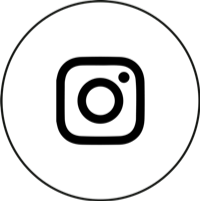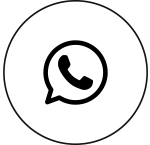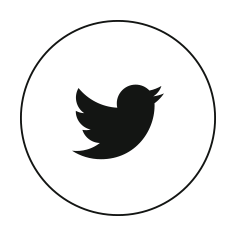Le dernier numéro de Jakarlo a offert aux téléspectateurs une scène aussi spectaculaire qu’alarmante. Le chroniqueur Badara Gadiaga, figure familière des plateaux, a choisi de revenir sur les accusations de viol portées contre Ousmane Sonko en 2021, alors même que la justice a déjà tranché et que ce dernier occupe désormais le poste de Premier ministre.
Cette relance soudaine, dénuée de tout élément nouveau, a déclenché une vive altercation sur le plateau, notamment avec le député Amadou Ba, et suscité une onde de choc sur les réseaux sociaux. Il faut désormais poser la question de la légitimité morale des voix médiatiques qui se permettent de juger les responsables publics, sans jamais soumettre leur propre conduite à la même exigence de transparence.
Dans une démocratie, la liberté d’expression est un pilier fondamental. Mais elle ne peut être invoquée pour masquer des règlements de comptes ou dissimuler les zones d’ombre personnelles de ceux qui s’en prévalent. Dans le cas du chroniqueur Badara Gadiaga, l’ironie est amère. L’homme qui s’érige en justicier télévisuel fait lui-même l’objet de soupçons graves. Selon les propos tenus par Amadou Ba, corroborés par un rapport de la Cour des comptes, Badara Gadiaga aurait occupé un poste à la Foire de Dakar sur la base d’un diplôme falsifié. Si ces faits sont avérés, ils ne relèvent pas d’un simple impair, mais bien d’une fraude qui entame durablement sa crédibilité.
Ce genre de révélations devrait suffire à pousser tout journaliste ou chroniqueur à la retenue, à la mesure, voire à une forme de discrétion. Au lieu de cela, certains choisissent l’escalade, préférant transformer les plateaux en tribunaux d’opinion. Ce faisant, ils desservent non seulement la qualité du débat public, mais affaiblissent aussi la confiance du public dans les médias. Dans des contextes similaires, comme en France avec l’affaire Morandini, ou aux États-Unis avec des figures tombées pour manquement à l’éthique, la responsabilité journalistique a été âprement discutée et, souvent, sanctionnée. Pourquoi le Sénégal devrait-il faire exception ?
L’affaire du chroniqueur Badara Gadiaga soulève une problématique plus vaste : celle du rôle des chroniqueurs dans la société contemporaine. Sont-ils des observateurs, des commentateurs, ou des procureurs improvisés ? Lorsqu’ils glissent vers ce dernier rôle, sans garde-fous éthiques, ils deviennent des fauteurs de trouble déguisés en sentinelles démocratiques. Il ne s’agit pas ici de protéger les figures publiques de la critique, mais d’exiger que ceux qui la formulent soient au-dessus de tout soupçon, ou, à tout le moins, transparents sur leur propre parcours.
Nous devons en finir avec cette impunité médiatique qui permet à certains d’attaquer avec virulence sans jamais répondre de leurs propres turpitudes. L’intégrité, dans ce métier, ne devrait pas être une option, mais une condition sine qua non. Les organes de régulation, les chaînes de télévision, mais aussi les citoyens, doivent réclamer davantage de rigueur et de cohérence dans la parole publique.
Car si la parole est libre, elle n’est pas sans conséquences. Et si les institutions doivent rendre des comptes, il faut que ceux qui les interpellent aient eux-mêmes le courage d’en rendre.
Article opinion écrit par le créateur de contenu : Cheikh Diouf.
Mis en ligne : 11/07/2025
—
La plateforme NOTRECONTINENT.COM permet à tous de diffuser gratuitement et librement les informations et opinions provenant des citoyens. Les particuliers, associations, ONG ou professionnels peuvent créer un compte et publier leurs articles Cliquez-ici.