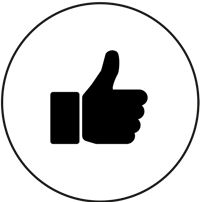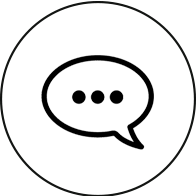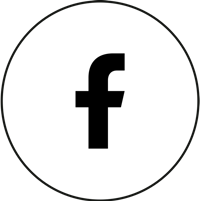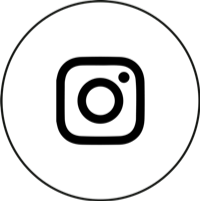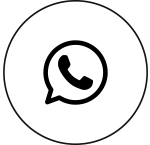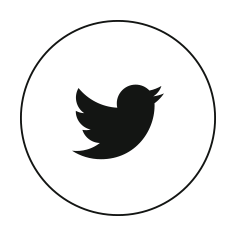Le 8 juillet, la justice tunisienne a prononcé des peines de prison allant jusqu’à 35 ans contre plusieurs figures politiques dans le cadre de l’ »Affaire du complot 2″. Parmi les condamnés : Rached Ghannouchi, leader du parti Ennahda, déjà incarcéré, et plusieurs anciens responsables politiques, jugés pour “complot contre la sûreté de l’État” et “formation d’une organisation terroriste”.
Ces lourdes peines s’ajoutent à une série de condamnations visant des opposants politiques depuis 2021. Cette instrumentalisation de la justice trahit les idéaux démocratiques de la Tunisie post-révolutionnaire.
Depuis le 25 juillet 2021, date à laquelle le président Kaïs Saïed a suspendu le Parlement et s’est arrogé les pleins pouvoirs, la Tunisie a connu un basculement inquiétant. Ce que certains ont initialement perçu comme une tentative de “redressement institutionnel” s’est transformé en une offensive systématique contre toute forme d’opposition. En quelques mois, les piliers de la démocratie en Tunisie, liberté d’expression, pluralisme politique, séparation des pouvoirs, ont été fragilisés au nom de la “sûreté de l’État”.
Les condamnations récentes s’inscrivent dans une logique où la justice semble devenir l’instrument du pouvoir exécutif. Le cas de Rached Ghannouchi est emblématique : ancien président du Parlement, il a été condamné à 14 ans de prison dans un procès qu’il a choisi de boycotter, dénonçant son caractère politique. D’autres personnalités, comme Nadia Akacha ou Rafik Abdessalem, sont lourdement condamnées par contumace. Le prétexte du “terrorisme” ou du “complot” est devenu un outil commode pour éliminer les voix dissidentes.
Concentration excessive des pouvoirs : En dissolvant le Parlement et en gouvernant par décrets, Kaïs Saïed a démantelé l’équilibre institutionnel construit depuis la révolution de 2011.
Répression ciblée de l’opposition : L’appareil judiciaire semble mobilisé non pour rendre justice, mais pour éliminer les adversaires politiques.
Atteinte aux libertés fondamentales : Journalistes, avocats et activistes font l’objet d’arrestations ou d’intimidations sous couvert de lutte contre la “désinformation”.
Délégitimation du processus démocratique : L’illusion d’un État de droit est maintenue par des procès-spectacles, mais la réalité est celle d’un régime autoritaire qui avance masqué.
Ce glissement autoritaire rappelle d’autres trajectoires politiques : en Turquie, Recep Tayyip Erdoğan a utilisé les accusations de complot pour museler ses opposants après la tentative de coup d’État de 2016. En Égypte, Abdel Fattah al-Sissi a instauré une chape de plomb sur l’opposition au nom de la stabilité. La Tunisie, autrefois saluée comme la seule réussite du Printemps arabe, semble aujourd’hui emprunter cette voie.
Les lourdes peines infligées à des figures politiques tunisiennes ne sont pas seulement des décisions judiciaires ; elles traduisent une dérive profonde vers l’autoritarisme. Il est crucial de dénoncer cette dynamique et de rappeler que la sécurité ne doit jamais servir de prétexte pour écraser les libertés. Le peuple tunisien mérite mieux que la peur et le silence. Il mérite une démocratie vivante, où l’opposition est un droit, et non un crime.
Il faut que la société civile, les intellectuels, les partenaires internationaux et tous les défenseurs des libertés s’unissent pour exiger le rétablissement d’un véritable État de droit en Tunisie. Face à la tentation autoritaire, notre silence serait complice.
Article opinion écrit par la créatrice de contenu : Soraya Malisse.
Mis en ligne : 10/07/2025
—
La plateforme NOTRECONTINENT.COM permet à tous de diffuser gratuitement et librement les informations et opinions provenant des citoyens. Les particuliers, associations, ONG ou professionnels peuvent créer un compte et publier leurs articles Cliquez-ici.