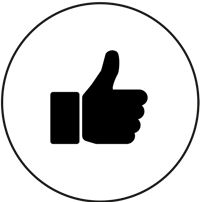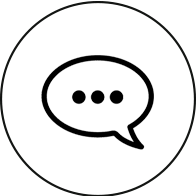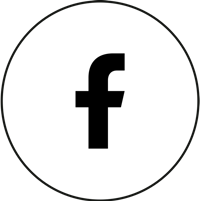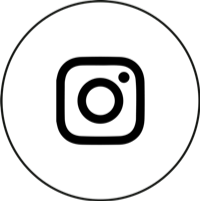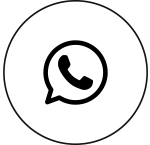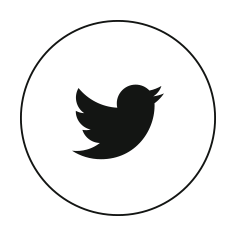Les concours publics, tels que ceux des douanes ou de l’École Nationale d’Administration (ENA), sont censés être des voies d’accès à la fonction publique basées sur le mérite, où seule la compétence devrait primer. Pourtant, il semble que de plus en plus, ce principe fondateur soit contourné par un autre facteur : les relations, ou « le bras long », qui jouent un rôle déterminant dans l’accès à ces concours.
Ce phénomène soulève des interrogations cruciales sur l’équité, la transparence et, surtout, sur la manière dont les élites sont formées et perpétuées dans notre société.
Le principe fondamental des concours publics est d’offrir à chaque citoyen, indépendamment de son origine ou de sa situation sociale, une chance égale d’accéder à un poste dans la fonction publique. Cependant, dans la réalité, l’accès à ces concours est de plus en plus perçu comme une course où les qualités intellectuelles, techniques et professionnelles ne sont pas les seuls critères de sélection. Loin de là. Au cœur de ce système, ce que l’on appelle communément « le réseau » ou « le bras long » s’est imposé comme un critère non négligeable, voire parfois décisif.
Prenons l’exemple des concours douaniers ou des écoles prestigieuses comme l’ENA. Ces concours, censés sélectionner les meilleurs candidats sur la base de leurs compétences, sont souvent entachés de pratiques informelles et de jeux d’influence. Ceux qui bénéficient de contacts ou de soutiens politiques ont des chances considérablement plus élevées de réussir, indépendamment de leurs performances réelles ou de leur préparation académique.
Dans certains pays, il est connu que les concours publics sont plus accessibles à ceux qui ont les bonnes connexions. Un étudiant brillant mais sans relations peut se voir écarté en faveur d’un autre qui, bien que moins qualifié, bénéficie de l’influence d’un parrain politique, d’un membre influent de la société ou d’un ancien élève de l’institution.
La conséquence immédiate de cette dérive est la remise en cause de l’intégrité des institutions publiques. Lorsque l’ascension professionnelle dépend davantage des relations que des compétences, la société toute entière en souffre. Non seulement cela crée un climat de frustration et de mécontentement parmi ceux qui n’ont pas accès à ces « réseaux », mais cela nuit également à l’efficacité des administrations publiques.
Des personnes moins qualifiées mais bien connectées se retrouvent à des postes stratégiques, ce qui peut compromettre la gestion des affaires publiques et l’innovation dans le service public.
Le problème est aussi sociétal. Le système favorise une homogénéité de l’élite qui se renforce elle-même à travers ces réseaux.
Les jeunes issus de milieux modestes ou de provinces lointaines, dépourvus des contacts nécessaires, se retrouvent souvent exclus de cette élite. Ainsi, les concours publics deviennent un moyen de renforcer la division sociale plutôt que de favoriser la méritocratie. Cela conduit à une uniformisation des profils dans les grandes institutions de l’État, et à une déconnexion de la réalité sociale du pays.
Cela affecte également la diversité des talents dans les institutions publiques. Si la réussite ne dépend plus des compétences, mais des relations, alors le spectre des talents qui parviennent à ces institutions devient de plus en plus limité. L’innovation, la créativité, et la capacité à répondre aux besoins de la population se trouvent ainsi étouffées par un système qui privilégie les intérêts d’un petit groupe.
Il est urgent de réformer le système des concours publics pour que ceux-ci retrouvent leur véritable vocation : celle de sélectionner les meilleurs éléments pour servir la société, indépendamment de leur origine ou de leur réseau. La lutte contre la corruption et les pratiques clientélistes devrait être au cœur de cette réforme, avec une mise en place de mécanismes de transparence plus stricts, l’anonymisation des épreuves, ainsi que des contrôles rigoureux sur les influences extérieures qui peuvent peser sur le processus de sélection.
Les concours publics devraient être un moyen d’assurer la sélection des meilleures compétences, pour une fonction publique plus juste et plus efficace. Cependant, lorsque les relations et les « bras longs » dominent ce système, il en résulte une inégalité flagrante qui prive la société d’un véritable accès égalitaire aux responsabilités publiques.
Article opinion écrit par le créateur de contenu : Fulgence.
Mis en ligne : 05/03/2025
—
La plateforme NOTRECONTINENT.COM permet à tous de diffuser gratuitement et librement les informations et opinions provenant des citoyens. Les particuliers, associations, ONG ou professionnels peuvent créer un compte et publier leurs articles Cliquez-ici.