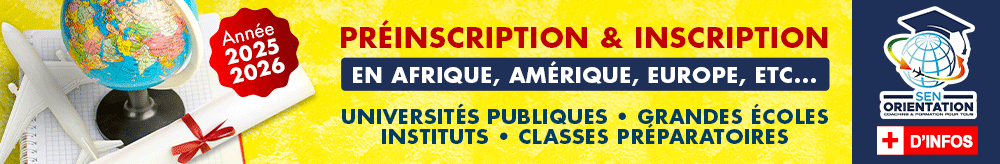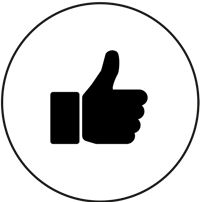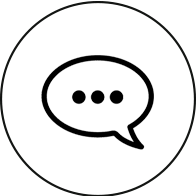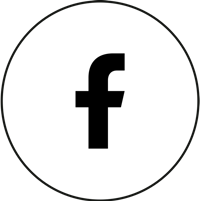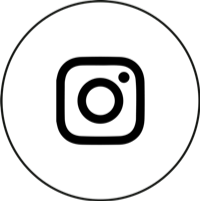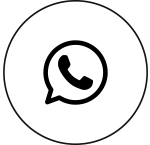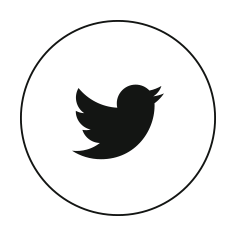Une étude récente publiée dans la revue scientifique Nature Chemistry par des chercheurs de l’Université d’Édimbourg a suscité beaucoup d’enthousiasme en annonçant la possibilité de produire du paracétamol à partir de déchets plastiques. Cette découverte, présentée comme une avancée pour le recyclage et la production pharmaceutique, mérite une analyse. En effet, malgré les promesses, cette méthode est loin d’être une solution miracle et soulève de nombreuses questions quant à sa faisabilité et son impact réel.
Le paracétamol est l’un des médicaments les plus couramment utilisés pour traiter la douleur et la fièvre. Traditionnellement produit à partir de dérivés pétrochimiques, sa fabrication est polluante et coûteuse. Dans ce contexte, l’idée de transformer des déchets en paracétamol semble séduisante. Les chercheurs écossais ont utilisé des bactéries génétiquement modifiées, Escherichia coli, pour transformer un composant du plastique PET en paracétamol. Cette approche hybride, combinant chimie et biologie, est présentée comme une innovation.
Cependant, une lecture attentive de l’étude révèle plusieurs limites majeures. Tout d’abord, le rendement de la transformation est extrêmement faible. Les bactéries ne produisent qu’une quantité limitée de paracétamol, insuffisante pour une application industrielle. Comme le soulignent les auteurs eux-mêmes, cette méthode est encore au stade expérimental et nécessitera de nombreuses optimisations avant de pouvoir être mise en œuvre à grande échelle.
De plus, cette étude n’est pas la première à promettre une solution révolutionnaire pour le recyclage des plastiques. Comme le rappelle Melissa Valliant de l’ONG Beyond Plastic, « Depuis des années, il ne passe jamais quelques mois sans qu’on ait une nouvelle ‘bactérie mangeuse de plastique’ ». Pourtant, aucune de ces découvertes n’a encore permis de résoudre le problème majeur de la pollution plastique. Les promesses des chercheurs et des entreprises soutenant ces projets doivent donc être prises avec prudence.
Plusieurs arguments viennent étayer ce scepticisme. Tout d’abord, la complexité du processus de transformation rend son industrialisation peu probable à court ou moyen terme. Comme le souligne Dylan Domaille, chimiste à la Colorado School of Mines, la méthode utilisée pour décomposer les bouteilles en plastique serait difficile à adapter à une échelle industrielle. Ensuite, les coûts associés à la modification génétique des bactéries et à la mise en place des infrastructures nécessaires pourraient rendre cette solution économiquement non viable.
Enfin, il est essentiel de considérer les impacts environnementaux et sanitaires potentiels de cette méthode. L’utilisation de bactéries génétiquement modifiées soulève des questions éthiques et écologiques. Les risques de contamination et les effets à long terme sur les écosystèmes ne sont pas encore bien compris et méritent une attention particulière.
Bien que l’idée de transformer les déchets en médicament soit séduisante, elle est loin d’être une solution miracle. Les limites techniques, économiques et environnementales de cette méthode doivent être prises en compte. Plutôt que de s’emballer pour des innovations encore au stade expérimental, il est crucial de continuer à investir dans des solutions éprouvées et durables pour le recyclage des plastiques et la production pharmaceutique.
Cessons de croire aux promesses trop belles pour être vraies et de se concentrer sur des actions concrètes et réalisables. Les défis environnementaux et sanitaires auxquels nous sommes confrontés nécessitent des solutions robustes et bien pensées, pas des expériences de laboratoire qui peinent à voir le jour.
Article opinion écrit par le créateur de contenu : Ansou Mané
Mis en ligne : 24/06/2025
—
La plateforme NOTRECONTINENT.COM permet à tous de diffuser gratuitement et librement les informations et opinions provenant des citoyens. Les particuliers, associations, ONG ou professionnels peuvent créer un compte et publier leurs articles Cliquez-ici.